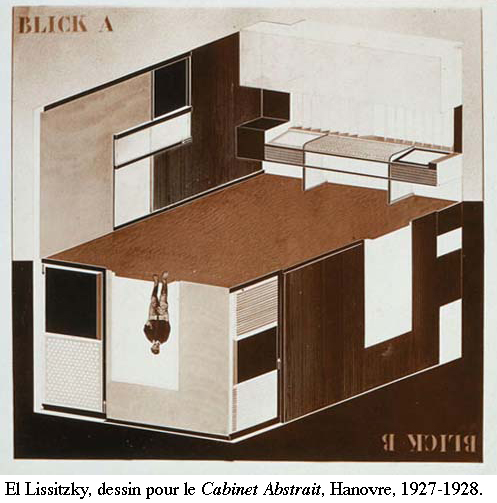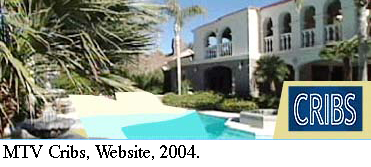Pourquoi est-ce que je m’emmerde si souvent dans les expositions d’art contemporain ?
Visiter une exposition d’art contemporain est une entreprise
pénible. Quiconque a déjà tenté l’expérience le sait, même si on préfère
en général le nier pour ne pas passer pour un imbécile. Trop souvent
on ne comprend pas. On cherche des explications qui, dans les rares
cas où elles sont disponibles, ne nous aident pas beaucoup. On
pense que si telle œuvre est dans un musée ce n’est pas pour rien
et qu’on devrait comprendre pourquoi. On se sent très bête. Lorsque
par miracle elles ne sont pas hors-service, on zappe entre des vidéos
trop longues pour être regardées intégralement, surtout debout (le
travail de Michael Asher à la Biennale de Venise de 1976
[1]
![]() ,
qui consistait en la mise à disposition des spectateurs de pliants
pour qu’ils puissent se reposer un peu, parle d’ailleurs bien mieux
du thème des pieds enflés dans l’art contemporain que moi). On se
prend les pieds dans des fils reliant des moniteurs trop petits (l’art
contemporain est-il ce dans quoi l’on trébuche juste après s’être
cogné contre la sculpture ?
[2]
).
,
qui consistait en la mise à disposition des spectateurs de pliants
pour qu’ils puissent se reposer un peu, parle d’ailleurs bien mieux
du thème des pieds enflés dans l’art contemporain que moi). On se
prend les pieds dans des fils reliant des moniteurs trop petits (l’art
contemporain est-il ce dans quoi l’on trébuche juste après s’être
cogné contre la sculpture ?
[2]
).
On s’arrête devant des claviers sans jamais savoir
si l’on ose toucher ou non, on lit des textes sur des panneaux accrochés
à 1m55 en se disant que ça serait quand même plus agréable de lire
tout cela dans son fauteuil à la maison. Pendant les vernissages,
on ne lit d’ailleurs pas trop parce que l’on se dit qu’il n’y aura
plus rien au buffet, qu’on reviendra. On ne revient en général pas
parce qu’il n’y a plus ni à se montrer, ni à boire.
| |
J’aime mieux être une star dans la rue qu’une merde au musée.
Nasty74 [3]
Le Louvre est mon atelier, la rue est mon musée.
Braco Dimitrijevic
Comme
le souligne Buren, le musée n’est qu’une parenthèse historique dans
l’histoire de l’art
[4]
,. Frises, statues équestres, intérieurs de cathédrales,
commandes publiques pour des places ou des jardins, la création a
eu sa place dans l’espace public bien avant la naissance du musée.
Si l’on considère l’ensemble de l’histoire de l’art, l’art dans la
rue est la norme. D’ailleurs, il suffit d’être un
rien attentif dans la rue, pour constater avec satisfaction la bonne
santé de cette tradition. Tags, graffs, affiches ou autocollants ![]() ,
proposent des formes artistiques souvent plus lisibles et plus vivantes
que celles que l’on voit dans les institutions, réalisées par des
artistes n’éprouvant pas la nécessité d’attendre l’aval institutionnel
pour s’exprimer. En parallèle, de nombreux artistes “institutionnalisés“
utilisent également la rue comme lieu d’exposition pour leurs œuvres
voire celles des autres.
,
proposent des formes artistiques souvent plus lisibles et plus vivantes
que celles que l’on voit dans les institutions, réalisées par des
artistes n’éprouvant pas la nécessité d’attendre l’aval institutionnel
pour s’exprimer. En parallèle, de nombreux artistes “institutionnalisés“
utilisent également la rue comme lieu d’exposition pour leurs œuvres
voire celles des autres.
|
Margaret Barron, invitée à la Tate Triennial de 2003, colle de toutes petites peintures réalisées sur une surface adhésive devant le bâtiment de la Tate Britain [5] . Son œuvre (faite des paysages urbains visibles depuis les endroits où sont apposés les autocollants) est ainsi démunie de toute protection et explore les limites de la visibilité. Elle remet également en cause la notion traditionnelle de permanence, d’éternité, traditionnellement liée à la peinture à l’huile. |
|
L’espace
public est utilisé ici grosso modo comme celui du musée : simplement
pour exposer une œuvre (même
si cet espace possède des caractéristiques qui lui sont propres).
Thomas Hirschhorn dit quant à lui avoir commencé à utiliser l’espace
public simplement parce que c’était le seul endroit où il pouvait
exposer
[6]
. Ensuite, alors qu’il est devenu un insider
du monde de l’art, il expose indépendamment
dans la rue ou dans l’institution. Ses constructions, refermées sur
elles-mêmes, lui permettent de se créer un espace autonome, fonctionnant
n’importe où, même dans les espaces à priori les plus hostiles à l’art.
Dans son Musée précaire Albinet
[7]
(installation éphémère construite au coeur d’un
quartier populaire parisien dans laquelle sont exposée à tour de rôle
des originaux de Malevitch, Mondrian, Duchamp, Le Corbusier, Beuys, Dali, Warhol
et Léger), il explore le pouvoir que peut avoir la recontextualisation
sur des œuvres majeures de l’histoire de l’art.
|
|
En exposant le même papier peint à l’intérieur et à l’extérieur de la galerie Wide White Space de Anvers [8] , Buren démontrait également, comme si Duchamp n’avait pas suffi, le pouvoir du contexte sur l’objet. L’espace public est alors utilisé à nouveau dans un but d’exposition mais surtout avec une visée démonstrative : révéler la vraie nature des espaces d’expositions est la priorité. |
La
rue dans l’art
Buren pense qu’il n’est pas possible d’exposer une œuvre indifféremment dans la rue ou dans le musée [9] . Il faut réfléchir au contexte, s’adapter. L’artiste qui veut “descendre“ dans la rue doit s’affranchir des règles instaurées par 100 ans d’une création majoritairement destinée aux musées. Il doit prendre en compte de nouvelles données. La rue est non seulement un cadre nouveau dans lequel l’artiste doit exposer mais elle est un vrai matériau avec lequel il faut apprendre à compter. On ne passe pas simplement des cimaises aux murs de la ville : un nouveau rapport à la rue doit s’instaurer, par la force des choses.
|
|
|
En
1982, à la Documenta 7, Beuys ![]() inaugurait un projet consistant à planter 7000 chênes à travers le monde
[10]
. Alors que les visiteurs payaient cinq Deutsch Mark
pour qu’un arbre soit planté, poussait son rêve d’une sculpture sociale
où chacun est artiste et chaque objet œuvre. Vingt ans plus tard, le monument
à Bataille de Hirschhorn
[11]
, installé dans un quartier populaire de Kassel et autogéré
par les habitants du lieu, dialogue merveilleusement avec des chênes à
présent immenses. Ici, le public est part intégrante du travail, la construction
sous forme de village est une structure ouverte entretenant une relation
intime avec les blocs d’habitations “réels“. La rue n’est plus ici un
lieu d’exposition “par défaut“ (comme au début du travail de l’artiste)
mais elle devient un matériau en soi, indispensable
à son œuvre. Quant au Musée précaire Albinet, son intérêt réside peut-être
moins dans l’idée de délocaliser des chefs-d’œuvre, ou dans la création
d’une sorte de version pauvre du musée (restant sommes toutes assez classique),
que dans le fait que la population locale, via un travail de plus d’une
année en “laboratoire“ ne
se contente plus d’être spectatrice mais devienne largement actrice.
inaugurait un projet consistant à planter 7000 chênes à travers le monde
[10]
. Alors que les visiteurs payaient cinq Deutsch Mark
pour qu’un arbre soit planté, poussait son rêve d’une sculpture sociale
où chacun est artiste et chaque objet œuvre. Vingt ans plus tard, le monument
à Bataille de Hirschhorn
[11]
, installé dans un quartier populaire de Kassel et autogéré
par les habitants du lieu, dialogue merveilleusement avec des chênes à
présent immenses. Ici, le public est part intégrante du travail, la construction
sous forme de village est une structure ouverte entretenant une relation
intime avec les blocs d’habitations “réels“. La rue n’est plus ici un
lieu d’exposition “par défaut“ (comme au début du travail de l’artiste)
mais elle devient un matériau en soi, indispensable
à son œuvre. Quant au Musée précaire Albinet, son intérêt réside peut-être
moins dans l’idée de délocaliser des chefs-d’œuvre, ou dans la création
d’une sorte de version pauvre du musée (restant sommes toutes assez classique),
que dans le fait que la population locale, via un travail de plus d’une
année en “laboratoire“ ne
se contente plus d’être spectatrice mais devienne largement actrice.
Dans le land art, l’utilisation de l’espace public en tant que tel comme
matière première est rendue encore plus évidente. Pourtant, il est intéressant
de noter que Smithson par exemple, même s’il travaille avec les matériaux
qu’il trouve sur les sites de sa création, utilise, parce qu’il ressent
le besoin de revenir au sein de l’institution, des supports papiers par
exemple pour l’œuvre qui sera la plus largement diffusée. Par la création
de cette œuvre bis, l’une des principales caractéristique de son travail
sera perdu : sa matérialité. En effet, en fabriquant des installations
destinées au musée et prévues pour dialoguer avec l’œuvre principale,
sur le site, il s’expose au risque de laisser le spectateur se contenter
d’un résidu. La séparation franche entre site et non-site
qu’opérait Smithson est-elle encore
de rigueur ? Le musée est-il, comme on pourrait le comprendre à la
lecture du tableau de Smithson, un non-site pour lequel on est en quelque
sorte dispensé de travailler ad hoc ?
Site |
Nonsite |
|
1. Open limits |
1. Closed Limits |
|
2. A Series of Points |
2. An Array of Matter |
|
3. Outer Coordinates |
3. Inner Coordinates |
|
4. Subtraction |
4. Addition |
|
5. Indeterminate Certainty |
5. Determinate Uncertainty |
|
6. Scattered Information |
6. Contained Information |
|
7. Reflection |
7. Mirror |
|
8. Edge |
8. Center |
|
9. Some Place (physical) |
9. No Place (abstract) |
| 10. Many |
10. One
[12]
|
Smithson dit :
“The
nonsite exists as a kind of deep three-dimensional abstract map that points
to a specific site on the surface of the earth.“
[13]
L’idée de cartographier le site dans le non-site
revient à dire que le musée ne doit pas être le lieu d’une œuvre réelle
(qui est destinée au site) mais d’une documentation à propos de l’œuvre,
d’une carte de l’œuvre. La démarche de Smithson n’est-elle cependant pas
paradoxale ? Il travaille sur des sites
mais semble ne pas pouvoir se passer des non-sites
pour justifier son œuvre. Pourquoi utiliser le non-site comme lieu de documentation ? L’art éphémère n’est en
général pas vu, dans sa forme originale, par beaucoup. L’art non plus.
La reproduction diffusée par livres et catalogues est en général la forme
sous laquelle l’œuvre est réellement diffusée. Pourquoi dès lors vouloir
à tout prix ajouter, par l’exposition de documents dans le musée, un niveau
de plus, un catalogue intermédiaire ? Le catalogue ne suffit-il pas
à légitimer ou à vendre un travail ?
|
|
|
Lorsque Braco Dimitrijevic expose le portrait géant d’un passant qu’il a rencontré au hasard sur les murs de la ville [14] , l’espace public ne lui sert pas uniquement de lieu d’exposition mais aussi de matière à sa création. Lorsqu’il expose des objets de la vie quotidienne dans le musée, il renonce même à la fonction d’exposition de la rue pour n’en garder que sa faculté à lui offrir son matériau. Une démarche similaire est d’ailleurs visible dans le travail de Mark Dion qui étale les déchets de l’extérieur au sein du cube blanc [15] .
Duchamp démontrait la puissance légitimante du musée en y déplaçant un objet.
Aujourd’hui, alors que la rue est utilisée à la fois comme musée et comme
matériau, un ready-made d’un type nouveau, sans déplacement, n’est-il
pas devenu possible ? ![]() Dans le travail de Gabriel Orozco par exemple, où l’on se trouve souvent
à l’extrême limite du fait et du non-fait (mais, comme le note Filiou,
pourquoi le fait ne serait-il pas
égal au non-fait
[16]
?), la photo n’est pas vraiment une œuvre en soi,
mais elle n’a pas uniquement un rôle de documentation non plus :
elle rend visible une œuvre qui existait mais qui restait invisible sans
son cadrage. Nul besoin de déplacer l’objet dans un musée (la photo peut
d’ailleurs très bien ne jamais y entrer). Comme l’énonçait un Greenberg
s’éloignant largement de ses thèses habituelles avec son concept de “art
at large“
[17]
, l’art est partout et prend n’importe quelle forme.
Benjamin quant à lui semble regretter la perte de l’aura de l’œuvre d’art
reproduite mécaniquement, mais il précise que cette aura peut très bien
se vivre sans œuvre d’art, n’importe où :
Dans le travail de Gabriel Orozco par exemple, où l’on se trouve souvent
à l’extrême limite du fait et du non-fait (mais, comme le note Filiou,
pourquoi le fait ne serait-il pas
égal au non-fait
[16]
?), la photo n’est pas vraiment une œuvre en soi,
mais elle n’a pas uniquement un rôle de documentation non plus :
elle rend visible une œuvre qui existait mais qui restait invisible sans
son cadrage. Nul besoin de déplacer l’objet dans un musée (la photo peut
d’ailleurs très bien ne jamais y entrer). Comme l’énonçait un Greenberg
s’éloignant largement de ses thèses habituelles avec son concept de “art
at large“
[17]
, l’art est partout et prend n’importe quelle forme.
Benjamin quant à lui semble regretter la perte de l’aura de l’œuvre d’art
reproduite mécaniquement, mais il précise que cette aura peut très bien
se vivre sans œuvre d’art, n’importe où :
“L’homme qui, un après-midi d’été, s’abandonne à suivre du regard le profil d’un horizon de montagnes ou la ligne d’une branche que jette sur lui son ombre cet homme respire l’aura de ces montagnes, de cette branche.“ [18]
|
|
|
D’après Danto [19] , l’apposition de ce sens caché est la condition sine qua non qui fait qu’une image ou un objet devienne œuvre d’art. Ce n’est pas, comme chez Duchamp, le déplacement dans le musée qui transforme le pissoir en fontaine mais l’apposition sur l’objet, par l’artiste, d’une interprétation “seconde“. Si la Pinched Ball de Orozco [20] n’est pas simplement une publicité pour un ballon de football c’est parce que, s’il représente certes un ballon de football, l’essentiel n’est pas là. L’essentiel est “à propos“ [21] . L’image se réfère à quelque chose d’autre qu’à ce qu’elle montre directement et cet infime glissement sémantique peut suffire à transformer une simple image en œuvre d’art. Si Schwitters, Duchamp, Warhol ou Rauschenberg collaient, montaient, remixaient, certains artistes contemporains semblent limiter leur intervention à un cadrage, à la mise en valeur d’éléments préexistants. L’idée de mort de l’auteur apparaît ici encore plus fortement que dans toutes les pratiques de collage, de sampling, d’appropriation… On ne déplace plus, on ne colle plus, on ne s’approprie plus : on donne juste à voir ou à ressentir au spectateur quelque chose qu’il aurait pu voir lui-même. Buchloh, en parlant d’un travail de Asher pour l’exposition Museum as Site, introduit un concept qui pourrait fort bien définir un grand nombre de pratiques contemporaines : l’infra-geste [22] . Pour Buchloh, l’infra-geste est un arrangement d’éléments appropriés. On pourrait certainement élargir cette définition à des pratiques où même l’arrangement est réduit à néant. Le travail d’Orozco explore cette limite entre fait et non-fait : si en déplaçant des boîtes de nourriture pour chat sur des pastèques, il opère certainement un infra-geste, certaines de ses photographies n’explicitent pas clairement si oui ou non une mise en scène a été effectuée [23] et, par là-même, semblent poser la question : “est-ce que le geste de l’artiste est nécessaire, son œil n’est-il pas suffisant ?“. Par une réduction drastique de l’ampleur du geste artistique, le spectateur est certainement appelé à occuper une place plus importante. Comme le pense Barthes, l’auteur aurait-il disparu au profit d’un scripteur et d’un lecteur prenant une part intégrante dans la constitution de l’œuvre ?
D’après Buren
[24]
, l’artiste travaillant dans l’espace public doit s’efforcer
d’éviter l’usure du regard engendré par la répétition du quotidien. Les
objets artistiques déposés dans la rue sont enclins à être ignorés beaucoup
plus rapidement que ceux qu’on l’on va voir ponctuellement dans les musées.
Pour lui, l’utilisation des objets quotidiens est possible dans l’art
destiné aux musées, mais pas dans celui destiné à la rue parce que ces
objets se confondraient trop avec ceux du quotidien. Pourtant, l’infra-geste,
le déplacement infime ![]() ,
l’altération, finalement la mise en abyme du contingent (là encore, le
rôle de la rue comme matériau est primordial) est peut-être le meilleur
moyen d’attirer l’attention du piéton blasé par les signes publicitaires
et autres enseignes tape-à-l’oeil. Cette pratique passionnante et, à mon
avis, relativement récente, permet, en travaillant à la limite du visible,
de proposer une alternative à la surenchère visuelle dictée par la société
de consommation. On pourrait comparer l’attitude de ces créateurs, répondant
à la pollution visuelle par l’invisible, à celle de Dada qui posait la
question de l’utilité de l’art qui ne peut opposer que l’absurde au carnage.
,
l’altération, finalement la mise en abyme du contingent (là encore, le
rôle de la rue comme matériau est primordial) est peut-être le meilleur
moyen d’attirer l’attention du piéton blasé par les signes publicitaires
et autres enseignes tape-à-l’oeil. Cette pratique passionnante et, à mon
avis, relativement récente, permet, en travaillant à la limite du visible,
de proposer une alternative à la surenchère visuelle dictée par la société
de consommation. On pourrait comparer l’attitude de ces créateurs, répondant
à la pollution visuelle par l’invisible, à celle de Dada qui posait la
question de l’utilité de l’art qui ne peut opposer que l’absurde au carnage.
Mauss
[25]
, théoricien du don-contre-don, explique que les objets
donnés retournent toujours d’une façon ou d’une autre aux donateurs eux-mêmes.
Dans certaines tribus, des pratiques toutes plus ou moins proches du potlatch
mettent en avant ce fait : on donne pour prouver sa puissance mais,
en retour, on est condamné à recevoir… Un pouvoir magique appelé
“Hau“ désigne ce contre-don auquel nul ne peut échapper, cette nécessité
qu’ont toutes choses à retourner à leurs expéditeurs. Le gaspillage -
dans notre société où une imprimante neuve livrée avec cartouches d’encre
coûte moins cher que les cartouches de remplacement, où l’on offre des
téléphones portables neufs ![]() et où les réparations automobiles affichent un prix si dissuasif que l’achat
d’un nouveau véhicule est souvent retenu comme la
meilleur solution n’est plus un effet secondaire de la consommation
mais bien un mode de consommation en soi.
et où les réparations automobiles affichent un prix si dissuasif que l’achat
d’un nouveau véhicule est souvent retenu comme la
meilleur solution n’est plus un effet secondaire de la consommation
mais bien un mode de consommation en soi. ![]() Lorsque, l’on trouve sur un trottoir un appareil avec un petit mot assurant
de son bon fonctionnement, on peut légitimement se demander si l’objet
est jeté ou offert. Ainsi le déchet, rejeté sur le trottoir, offert par
la rue à l’artiste, devient un matériau riche de sens et de questionnement,
qui aspire peut-être à retourner à son donateur.
Lorsque, l’on trouve sur un trottoir un appareil avec un petit mot assurant
de son bon fonctionnement, on peut légitimement se demander si l’objet
est jeté ou offert. Ainsi le déchet, rejeté sur le trottoir, offert par
la rue à l’artiste, devient un matériau riche de sens et de questionnement,
qui aspire peut-être à retourner à son donateur. ![]()
|
|
||
Lorsqu’une œuvre entre au musée, en étant exclue de ce système d’échange, n’est-elle pas autant sacrifiée que sanctifiée [26] ? Pour Bataille [27] , l’homme se différencie de l’animal parce qu’il ne se contente pas de survivre mais qu’il se dégage un excédent d’énergie qu’il s’efforce de dépenser de façon irrationnelle, improductive. Le travail de l’artiste est sans doute la meilleure illustration de cette thèse.
Comment le musée répond-t-il aux formes d’art qui ne lui sont pas directement destinées ? Trop souvent, l’institution semble peiner à trouver des solutions originales pour montrer la création artistique contemporaine. La majorité des vidéos d’artistes ne devraient-elle pas être regardées dans une vraie salle de cinéma ou tranquillement chez soi ? La documentation papier sur tel ou tel projet ou réalisation n’est-elle pas plus lisible dans un livre qu’accrochée au mur ? Les artistes ayant l’habitude de travailler avec les particularités du réseau Internet rêvent-ils vraiment d’une petit écran au fond d’une salle sombre ?
Un problème indéniable se pose en réalité trop souvent : le musée a tendance
à devenir non plus le lieu où les œuvres sont exposées mais celui où l’on
peut prendre connaissance de ce qui existe, tout en sachant que les œuvres
ne sont pas présentées dans un contexte idéal voire pas présentées du
tout en tant que telles. Il est également inquiétant de voir à quel point
la majorité des conservateurs ou des curateurs ne se soucient pas de la
place du spectateur au sein de l’exposition.
|
|
El Lissitzky proposait, dans les années 20 déjà, avec son Cabinet Abstrait [28] , une structure mouvante (dans laquelle le spectateur pouvait intervenir) qui permettait de cacher certains tableaux pour éviter que le regardeur ne soit submergé et pour lui permettre de se concentrer pleinement sur quelques œuvres. |
Le musée actuel semble être fort éloigné de ces préoccupations et reste très attaché à une conception encyclopédique fortement nuisible à la lecture des œuvres !
Et si le
musée n’était plus une structure en adéquation avec la création actuelle ?
Et si, aujourd’hui, l’histoire de l’art et le musée étaient terminés ?
Et si le musée dans sa forme actuelle devait être considéré non plus comme
un lieu d’exposition mais comme un objet quasi archéologique ? ![]()
|
Certains travaux semblent envisager une telle hypothèse : lorsque Frederick Wilson mine le musée d’histoire de Baltimore [29] en réécrivant l’histoire proposée à partir des pièces des collections, le sujet d’exposition devient le musée lui-même. Idem lorsque le Musée d’Ethnographie de Neuchâtel met en abyme ses propres collections dans des vitrines axées chacune sur une muséographie particulière ayant été, à un moment ou à un autre, dominante au sein de ce même musée [30] .
|
|
Le musée est une invention récente qui a vu le jour à la fin du 18ème,
dans le but de glorifier les créations de l’homme mais aussi d’abriter
les restes des civilisations colonisées et pillées par les Empires Occidentaux.
Il est troublant de remarquer que la notion d’art, dans la signification
actuelle du mot, est née quasiment en même temps que celle de musée
[31]
. Ensuite, le terme a été appliqué rétroactivement à
une multitude d’objets. Comment peut-on appliquer aux peintures des grottes
de Lascaux un concept du 18ème ? Le terme a été souvent
utilisé en réalité pour justifier l’annexion des travaux de la Renaissance,
de l’Antiquité ou du Moyen-Age. En arrachant
ces œuvres de leur contexte d’origine (églises, palais, intérieurs privés,
places publiques…) et en les exposant aux côtés des créations artistiques
contemporaines, on pouvait ainsi montrer à quel point ces dernières étaient
issues d’une lignée prestigieuse. Le British Museum prend dès lors la
forme d’un temple grec alors même qu’il abrite les frises du Parthénon.
![]()
Plus intéressant peut-être, l’art pour l’art (l’art tout court peut-être) n’est rendu possible que par le musée. Auparavant, on peignait pour : pour la gloire du prince, pour immortaliser ses victoires et sa grandeur, pour enseigner, pour faciliter aux croyants l’accès aux scènes bibliques, pour honorer une commande d’un riche particulier qui voulait orner ses appartements d’un portrait. Depuis le musée, on peut peindre sans autre but que d’y entrer et d’y être admiré. La libération progressive de la peinture vis-à-vis du sujet doit peut être plus à la naissance du musée qu’à l’idée greenbergienne de peinture recherchant naturellement son essence la plus pure par une simplification toujours plus poussée.
A propos de l’essence de l’art, la théorie de Danto, fort différente de celle de Greenberg, est des plus intéressantes. Même si Claude Hary-Schaeffer qualifie le style de Danto de “limpide, allègre et plein d’humour“ [32] , j’éprouve tout de même la nécessité d’essayer de résumer sa théorie sur la fin de l’art pour mieux la comprendre. Voici donc un condensé de ce que l’on trouve sur cette question dans trois de ses ouvrages principaux : La Transfiguration du banal [33] , L’Assujettissement philosophique de l’art [34] et Après la fin de l’art [35] .
Depuis Vasari, l’art est considéré comme étant en progrès continuel [36] . Le progrès dont on parle alors est celui qui fait tendre vers une duplication de plus en plus réaliste des procédés optiques. Pourtant, la fidélité optique n’a en réalité été un but artistique qu’à deux périodes de l’histoire : dans la Grèce antique et en Europe à la Renaissance [37] . On ne peut donc pas parler d’une évolution darwiniste de l’art. Pourtant, pour que l’histoire de l’art existe, il faut qu’une force, qu’un but la guide. Si l’on considère que l’Art n’est qu’une succession d’expressions individuelles, les choses ne font que se suivre sans rapport et l’Histoire de l’art n’existe pas vraiment.
C’est alors que Danto fait intervenir Hegel. Celui-ci croit à une continuité historique, à une forme de progrès (donc également à une fin de l’histoire), mais à un progrès de l’ordre du cognitif et non d’une technique toujours plus affinée d’équivalence perceptive. L’art serait une forme transitoire vers un certain type de connaissance et la connaissance en question n’est autre que celle de la conscience de soi. En résumé, l’histoire de l’art serait guidée par une quête égocentrique, par une recherche du moi. Avec l’avènement de sa propre philosophie, répondant à la question qui a guidé toute son évolution, à savoir “qu’est-ce que l’art ?“, l’art, n’étant qu’une forme transitoire vers cette réponse, cessera d’exister [38] .
Troisième temps de l’analyse : les Boîte Brillo d’Andy Warhol ![]() .
Danto pense qu’avec cette œuvre, l’art a atteint une limite et qu’on a
enfin répondu à la question qu’il se pose. L’art découvre ici sa vraie
nature philosophique et peut cesser d’exister
[39]
.
.
Danto pense qu’avec cette œuvre, l’art a atteint une limite et qu’on a
enfin répondu à la question qu’il se pose. L’art découvre ici sa vraie
nature philosophique et peut cesser d’exister
[39]
.
Pourquoi ?
Alors que Duchamp montre avec sa fontaine qu’une qualité esthétique peut être prêtée à un objet quotidien [40] , Warhol montre que l’art ne peut se définir par des critères visuels, l’objet et l’œuvre étant exactement semblables (plus même de “R.Mutt“) , mais ce n’est pas tout. L’objet choisi n’a en soi aucune valeur esthétique. Exactement semblable à un objet quotidien auquel on n’attribue aucune valeur esthétique, l’œuvre interpelle. Pourquoi la considère-t-on immédiatement comme de l’art ? Une fois de plus, qu’est-ce que l’art ? Si cette œuvre marque réellement une limite de l’art, c’est parce qu’elle démontre que l’art se définit par une représentation qui n’est pas simplement constituée d’une représentation primaire (ce qu’elle montre visuellement) mais qu’il fait y ajouter une représentation secondaire [41] . L’œuvre d’art est toujours “ à propos “ de quelque chose. Les boîtes Brillo de Andy Warhol parlent de quelque chose d’autre que de la simple impression visuelle qu’elles dégagent. Les boîtes Brillo du supermarché, elles, sont des boîtes Brillo. L’essence de l’art ne se définit pas par des critères esthétiques mais intentionnels [42] . Ceci démontré, la progression historique de l’art ne peut que s’arrêter.
L’art n’est pas pour autant condamné, parce que la quête philosophique de lui-même n’était pas son seul but. Il entre dans une phase posthistorique (théorisée également par Belting, Dimitijevic ou Kosuth entre autres [43] ) ou son importance philosophique où historique ne sera plus aussi grande que celle que nous nous étions habitués à lui attribuer [44] . L’art ne sera plus lié à une histoire faite de progrès. Bien sûr, des nouvelles formes représentationnelles sont loin d’être exclues… mais elles ne seront plus considérées comme des progrès [45] . L’art peut devenir pluriel, l’histoire de l’art occidental cesser d’être toute puissante, et surtout, comme le souligne Jean-Marie Schaeffer :
“cela signifie aussi que, contrairement à ce dernier (l’art moderniste), il (l’art posthistorique) s’affranchit de la philosophie : son intérêt humain sera donc peut-être plus grand que celui de l’art monderniste, puisqu’il sera capable de remplir de multiples fonctions sociales, comme cela a été le cas aux époques prémodernistes“. [46]
|
|
L’art affirme ou plutôt réaffirme aujourd’hui son rôle social. Les rampe
de skate du groupe Simparch
[47]
, les cinémas nomades d’Ela Gibbs
[48]
sont certainement plus proche des propositions socialistes
de Maïakovski que les avant-gardes russes elles-mêmes n’ont pu l’être.
![]()
“nous n’avons pas besoin d’un mausolée de l’art où des œuvres mortes sont adorées, mais d’une vivante usine de l’esprit humain dans les rues, dans les tramways, dans les usines, dans les ateliers et les maisons des travailleurs.“ [49]
Aujourd’hui,
l’ultime idéal largement diffusé par les médias - est l’isolement total :
conduire une voiture aux vitres teintées et à la sono couvrant tout bruit
venant de l’extérieur, voyager sur une île déserte, habiter une villa
avec un jardin assez grand pour empêcher tout regard extérieur, profiter
de sa piscine privée, de son un jet privé, de son cinéma privé… ![]()
|
|
Une émission comme MTV Cribs [50] vend largement ce modèle, aux adolescents déjà : seules les stars ont le privilège de se couper du monde en se construisant des châteaux forts sécurisés. Les quartiers résidentiels des banlieues américaines, entourés de barbelés et de miradors, démocratisent quelque peu ce rêve. Le musée représente ce même type d’idéal : il faut être une star de l’art pour y entrer et être sûr que le monde extérieur ne remettra plus jamais en cause sa réussite et la valeur symbolique de ses œuvres… Comme on va en voyage pour vérifier l’image que l’on s’est construite d’un pays, comme l’on fait un reportage pour illustrer un discours préétabli, on va au musée non pas pour découvrir mais bien pour vérifier des connaissances, pour se recueillir. Si son entrée au musée signifie certainement la consécration pour une œuvre, il s’agit d’une consécration posthume… La visite, dans le silence, prend l’allure d’une veillée funéraire, et l’œuvre celle d’un corps mort. Certains artistes refusent pourtant de laisser mourir leurs œuvres et, paradoxalement, en les abandonnant à l’espace public, en les inscrivant dans une vie sociale qui n’existe dans les musées que sous forme de simulacre, ils leur offrent un supplément de vie. Le rapport entre spectateurs et œuvres, dans le musée, est largement biaisé car la valeur symbolique de l’œuvre est comme préétablie par le fait qu’elle a été choisie par l’institution. Ainsi, les visiteurs ne peuvent qu’accepter la légitimité et l’intérêt des travaux présentés.
Quelques entreprises très intéressantes mais encore isolées montrent que le musée n’est pas condamné mais qu’il a tout à gagner à engager un dialogue d’un type nouveau avec l’art qu’il veut conserver, promouvoir et conserver. On a pu voir, à la Documenta XI ou à la Biennale de Lyon 2003 par exemple, de véritables salles de cinéma où les vidéos étaient projetées en boucle, dans un cadre idéal. Dans le Nord de l’Europe notamment, on trouve de plus en plus de musées où les départements pédagogiques occupent une place importante du dispositif d’exposition avec des salles informatique où sont présentées une partie des œuvres numériques, des bibliothèques en libre accès, des salles de cours et de conférences et des scènes (pour que la performance ne soit pas condamnée à être uniquement documentée au sein de l’institution). Plus intéressant encore, le bureau Temporary Contemporary (devenu Baltimore Contemporary Museum [51] étant aujourd’hui devenu en partie un musée “fixe“) ou la galerie Ikon [52] à Birmingham répondent à la volonté des artistes d’inscrire leur œuvre dans l’espace public en finançant des travaux “off site“ ou “x-site“.
|
Autre cas intéressant : alors que l’art moderne est en
général pensé pour le musée, un retournement s’est opéré à Bilbao
où l’architecte Frank O. Gehry a construit une
partie du bâtiment en fonction de l’une des œuvres à exposer, une
sculpture monumentale de Serra.
[53]
|
|
Même si le musée s’adapte ici à l’œuvre et non l’inverse, le
Guggenheim de Bilbao n’est certainement pas un exemple à suivre étant
donné que l’œuvre est avant tout utilisée ici pour mettre en valeur le
bâtiment lui-même, véritable œuvre exposée dans la ville basque. Comme
au Musée Juif de Berlin de Libeskind, la lecture des expositions est largement
compromise par une architecture splendide mais trop présente. Autre piste
novatrice, celle suivie par certains musées canadiens notamment qui rendent
provisoirement certains objets du musée aux descendants de ceux à qui
ils ont été dérobées, à l’occasion de fêtes rituelles
[54]
. Les objets retrouvent alors leur rôle d’usage, leur
pouvoir magique. Le rôle neutralisant du musée, son cannibalisme
[55]
![]() est ainsi provisoirement suspendu. Dans les années 1980, les écomusées
atteignent leur apogée en France, au Creusot en particulier. L’écomusée
a une valeur d’exemple car il montre bien que l’objet muséal est un objet
mort : au Creusot, l’écomusée a été nécessaire justement parce que
l’objet d’exposition, le monde industriel, n’était pas encore assez mort
pour entrer dans un musée classique
[56]
. A la galerie Ikon, Braco Dimitrijevic fait entrer des
objets de la rue dans le musée. Si sa démarche est pertinente, ce n’est
pas tant par le déplacement qu’il opère - le même, déjà largement consommé,
que Duchamp a introduit - que le fait qu’il renvoie ensuite ces objets
à leur usage premier. Il rend ainsi possible un dialogue réel entre extérieur
et intérieur, non pas, comme on le voit trop souvent, en proposant à l’intérieur
une documentation de ce qui est exposé sur le trottoir devant la salle
d’exposition, mais en refusant de laisser le musée avaler définitivement
l’œuvre.
est ainsi provisoirement suspendu. Dans les années 1980, les écomusées
atteignent leur apogée en France, au Creusot en particulier. L’écomusée
a une valeur d’exemple car il montre bien que l’objet muséal est un objet
mort : au Creusot, l’écomusée a été nécessaire justement parce que
l’objet d’exposition, le monde industriel, n’était pas encore assez mort
pour entrer dans un musée classique
[56]
. A la galerie Ikon, Braco Dimitrijevic fait entrer des
objets de la rue dans le musée. Si sa démarche est pertinente, ce n’est
pas tant par le déplacement qu’il opère - le même, déjà largement consommé,
que Duchamp a introduit - que le fait qu’il renvoie ensuite ces objets
à leur usage premier. Il rend ainsi possible un dialogue réel entre extérieur
et intérieur, non pas, comme on le voit trop souvent, en proposant à l’intérieur
une documentation de ce qui est exposé sur le trottoir devant la salle
d’exposition, mais en refusant de laisser le musée avaler définitivement
l’œuvre.
Un Malevitch, un Rothko ou un Soto perdent l’essentiel de leur sens lorsqu’ils sont reproduits en catalogue. De la même manière, la Jetée en spirale ou le Reichstag emballé n’ont aucun sens en photographie sur une cimaise. Le musée est un site. Un site avec ses particularités, son histoire, mais un site qu’il faut investir avec de vrais travaux prenant en compte ses spécificités et non pas avec des rebus d’œuvres. Benjamin parle déjà de ce type de problème lorsqu’il évoque la perte de l’aura de l’œuvre provoquée par sa reproduction mécanisée.
“A la production même la plus perfectionnée d’une œuvre d’art, un facteur fait toujours défaut : son hic et nunc, son existence unique au lieu où elle se trouve. Sur cette existence unique, exclusivement s’exerçait son histoire“ [57]
L’exposition d’une œuvre reproduite mécaniquement ne peut dès lors rivaliser avec celle d’une œuvre “authentique“. Ce problème ne s’étendrait-il pas en réalité à l’ensemble des œuvres dont le “hic et nunc“ n’est pas compatible avec celui du lieu dans lequel il est exposé ? A part la peinture moderne et une partie de l’art contemporain, quelle création a-t-elle été pensée vraiment pour l’univers aseptisé du musée ? De plus, même les œuvres pensées pour le cube blanc sont coupées de leur contexte et rares sont les expositions qui tentent de renseigner le spectateur sur les conditions de création. Doit-on vider les musées des œuvres créées pour des églises ou des palais ? Doit-on les garder pleins mais en ne les considérant plus que comme le témoignage historique d’une muséographie périmée ?
Quant aux œuvres de l’avenir, elles poseront certainement un problème encore
plus complexe aux institutions. L’apparition du numérique aura certainement
autant d’impact sur l’art qu’a pu en avoir l’apparition de la photographie.
Le numérique libère non seulement la photographie de son rôle de témoignage
de la réalité, mais, plus fondamentalement encore, il libère l’œuvre de
sa matérialité
[58]
. L’œuvre n’existe plus sans l’intermédiaire du lecteur
et l’idée de Duchamp que le regardeur fait l’œuvre est plus vraie que
jamais. ![]()
Comment le musée peut-il rendre compte de ces nouvelles formes ? Leur donner une présence physique tuerait plus que jamais leur particularité et, par là-même, leur “aura“. Le Guggenheim tente de répondre à ce problème par un projet de musée virtuel online [59] . Il ne s’agit pas, comme beaucoup de musées le proposent, d’offrir un aperçu de ses collections sur Internet, mais d’exposer virtuellement une collection d’œuvre virtuelles n’étant montrées nulle part ailleurs. Ainsi, la désintégration physique des œuvres ne signifie pas la disparition des musées mais leur adaptation.
Si
je m’emmerde aussi souvent dans les musées, ce n’est pas que les œuvres
présentées soient inintéressantes - elles sont très souvent passionnantes
mais parce que, souvent, elles ne sont pas exposées. Le musée doit s’adapter
aux formes de création actuelles, faire de nouvelles propositions d’exposition,
pour rendre compte de la diversité de la création contemporaine et pour
ne plus en exposer que des résidus.
L’artiste, quant à lui, ne peut pas créer sans prendre en compte
le lieu d’exposition, aucun lieu n’étant neutre et aucune œuvre autonome.
L’artiste doit penser son mode d’exposition, être attentif à ne pas abandonner
son travail aux mains d’un curateur qui éclipserait sa production derrière
l’exhibition de sa propre démarche
[60]
. Si le grand public
se rue dans les expositions d’art moderne et a plutôt tendance à bouder
celles d’art contemporain ![]() ,
ce n’est certainement pas uniquement parce qu’il a systématiquement une
génération de retard, mais également parce que l’art moderne est présenté
dans son contexte, ce qui le rend infiniment plus lisible que l’art contemporain
dans la forme où il est en général présenté aujourd’hui.
,
ce n’est certainement pas uniquement parce qu’il a systématiquement une
génération de retard, mais également parce que l’art moderne est présenté
dans son contexte, ce qui le rend infiniment plus lisible que l’art contemporain
dans la forme où il est en général présenté aujourd’hui.
[1]
Ambiente arte, dal futurismo ad oggi, Venice Biennale, July 18-October 16, 1976.
[2]
Barett Newman déclarait dans les années cinquante “La
sculpture c’est ce contre quoi l’on se cogne quand on recule pour
regarder un tableau“, voir Rosalind Krauss, L’originalité de l’avant-garde
et autres mythes modernistes,
Macula, Paris, 1993, p. 117.
[3]
Bischoff, Gautier, ECR, Malland, Julien, Kapital,
Un an de graffiti à Paris,
Paris : Editions alternatives, 2000,
p. 19.
[4]
Voir : Buren, Daniel, A force de descendre dans
la rue, l’art peut-il enfin y monter ?, 11/24, pp. 63-65.
[5]
Voir : Days like these, Catalogue de l’exposition, Tate Triennial Exhibition
of Contemporary British Art, 26 February-26 may 2003, Tate Britain,
London, pp. 36-41.
[6]
Gingeras, Alison, “Thomas Hirschhorn, grâce à la bêtise“,
in : artpress, n.
239, 1998, pp. 22.
[7]
Site officiel : http://www.leslaboratoires.org/
[8]
Buren, Daniel, Galerie Wide White Space, Antwerpen,
1969.
[9]
Voir : Buren, Daniel, A force de descendre dans
la rue, l’art peut-il enfin y monter ?, 11/24, pp. 63-65.
[10]
Beuys, Joseph, 7000 chênes,
Documenta 7, Kassel.
[11]
Hirschhorn, Thomas, Bataille Monument, Documenta 11, Kassel.
[12]
Kepes, Gyorgy, “Art of the Environnment“, New York,
Braziller, 1972, in Writings,
pp. 109.
[13]
Cummings, Paul, “Interview with Robert Smithson for
the Archives of American art/Smithsonian Institution“, in Writings, p.155.
[14]
Voir : Braco Dimitrijevic: Slow as light, fast
as thought, Catalogue de
l’exposition, Museum Moderner, Vienna, 1994.
[15]
Voir par exemple : Corrin, Lisa Graziose, Mark
Dion : Contemporary Artist,
Phaidon, London, 1997.
[16]
Filiou instaure en 1968 le
"Principe d'équivalence ; bien fait, mal fait, pas fait".
[17]
Voir le
chapitre “Les tremblées de la réflexion“ dans : Greenberg, Clement,
Art and culture : critical essays,
Boston : Beacon Press, 1961 ; fr. Art et culture : essais
critiques, trad. par Ann Hindry, Paris : Macula, 1997.
[18]
Benjamin, Walter, “L’œuvre d’art à l’époque de sa reproduction
mécanisée“, in : Ecrits français par Walter Benjamin, Editions Gallimard, Paris, 1991.
[19]
Voir : Danto, Arthur, La transfiguration du banal,
Une philosophie de l’art, Seuil, Paris, 1989 (traduction française Jean-Marie
Schaeffer). The Transfiguration of the Commonplace, Harvard University
Press, 1981, p. 16.
[20]
Orozco, Gabriel, Pinched Ball, 1993.
[21]
Voir “Vers un musée catalogue“ ci-dessous.
[22]
Buchloh, Benjamin, Essais historiques II, Art contemporain,
Art édition, Villeurbanne, 1992, pp. 133-34.
[23]
Voir le très bel ouvrage sur sa pratique photographique :
Gabriel Orozco: Photographs, Publication à l’occasion de l’exposition “Gabriel Orozco :
Extension of reflections“, Hirschhorn Museum, London, 10 june-6 september
2004, Steidl, London, 2004.
[24]
Buren, Daniel, A force de descendre dans la rue,
l’art peut-il enfin y monter ?,
11/24, pp. 76-79.
[25]
Mauss, Marcel, “Essai sur
le don, forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïques“,
dans : Marcel Mauss, Sociologie et anthropologie, Presses universitaires de France, Paris, 1960. Voir aussi
à ce propos Godelier, Maurice, L’énigme du don, Fayard, Paris, 1997.
[26]
Voir cet excellent article : Pomian, Krzysztof,
"Entre l'invisible et le visible: la collection"
dans : “Collectionneurs, amateurs
et curieux“, Paris, Venise
: XVIe-XVIIIe siècle, Gallimard, Paris, 1987.
[27]
Voir : “La notion de dépense“ dans : Bataille,
George, La part maudite, Les éditions de minuit, Paris, 1967.
[28]
Voir l’excellent sit sur El lissitzky : http://www.getty.edu/research/conducting_research/digitized_collections/lissitzky/
[29]
Corrin, Lisa G., Mining
the museum: an installation by Fred Wilson,
New Press, Maryland,1994.
[30]
Installation appelée “Haut
de la Villa de Pury: l'ethnographie en quatre étapes“. Voir sur le
site du musée : http://www.men.ch/expositions.asp/1-0-21336-99-31-104-2/
[31]
Une étude précise mériterait d’être entreprise sur ce
point précis mais notons que le Petit Robert 2002 par exemple ne date
l’apparition de la notion de “Beaux-Arts“ qu’en 1752 !
[32]
Danto, Arthur, Après la fin de l’art , Seuil, Paris, 1996
(traduction française Jean-Marie Schaeffer). Beyond the Brillo
Box The Visual Arts in Post-Historical Perspective, Farrar, Straus & Giroux,
1992, quatrième de couverture.
[33]
Danto, Arthur, La transfiguration du banal,
Une philosophie de l’art, Seuil, Paris, 1989 (traduction française Jean-Marie
Schaeffer). The Transfiguration of the Commonplace, Harvard University
Press, 1981.
[34]
Danto, Arthur, L’Assujettissement philosophique
de l’art , Seuil, Paris, 1993 (traduction française Jean-Marie
Schaeffer). The Philosophical Disenfranchisement of Art, New York, Columbia
University Press, 1986.
[35]
Après la fin de l’art.
[36]
L’Assujettissement philosophique de l’art , p. 117.
[37]
Idem, p. 122.
[38]
Idem, p. 142.
[39]
Après la fin de l’art , p. 19.
[40]
La transfiguration du banal, Une philosophie de l’art, p. 36.
[41]
Après la fin de l’art , p. 20.
[42]
La transfiguration du banal, Une philosophie de l’art, p. 16.
[43]
Voir : Belting, Hans, L’histoire de l’art est-elle
finie ?, traduction
française par Yves Michaud, Editions Jacqueline Chambon, Nîmes, 1989,
Das Ende der Kunstgeschichte ?,
Deutscher Kunstverlag, Munich, 1983. Kosuth,
Joseph, Art after philosophy and after : collected writings, 1966-1990, The MIT
Press, London, 1991. Dimitrijevic, Braco, Tractatus post-historicus, 1974.
[44]
L’Assujettissement philosophique de l’art , pp. 146-147
[45]
La transfiguration du banal, Une philosophie de l’art, pp. 24-25.
[46]
Idem, pp. 17-18.
[47]
A propos du projet pour la Documenta 11 notamment, voir :
www.channel.creative-capital.org
[48] www.whitechapel.org/programme/index1.html
[49]
Maïakovski,
“Meeting ob iskousstvé“ in : Iskousstvo Kommouni, No 1, 7 décembre 1918.
[50] Cette émission propose des reportages où l’on montre les maisons des stars du showbiz américain. Voir, sur le site officiel de la chaîne : http://www.mtv.com/onair/cribs/
[51]
www.contemporary.org
[52]
www.ikon-gallery.co.uk
[53]
A propos de la “Fish Gallery“ de Gehry, construite pour
abriter le Snake de Serra,
voir :
http://www.guggenheim.org/press_releases/downloads/richard_serra_release.pdf
[54]
Voire le rapport de la commission royale sur les peuples
autochtones, Affaires indiennes et du Nord, Canada sur www.ainc-inac.gc.ca/ch/rcap/sg/sia6a_f.html
[55] Voir le catalogue de l’excellente exposition du Musée d’Ethnographie de Neuchâtel sur le sujet : Gonseth, Marc-Olivier, Jacques Hainard et Roland Kaehr, Le musée cannibale, Catalogue de l’exposition, Musée d’Ethnographie de Neuchâtel, 9.3.2002-2.3.2003, Men, Neuchâtel, 2002.
[56]
Voir la thèse passionnante d’Octave Debary : Debary,
Octave, La fin du Creusot ou l’art d’accommoder les restes, Paris : Ecoles des hautes études en sciences sociales,
2000.
[57]
Benjamin, Walter, “L’œuvre d’art à l’époque de sa reproduction
mécanisée“, in : Ecrits français par Walter Benjamin, Editions Gallimard, Paris, 1991.p.
141.
[58] Sur ce sujet voir : Couchot Edmond, Hillaire, Norbert, L’Art numérique, Paris : Flammarion 2003.
[59]
Voir la présentation du projet sur : http://www.guggenheim.org/exhibitions/virtual/virtual_museum.html
[60]
Voir le point de vue de Buren qui critique le curateur
superstar sur un site proposant un sujet passionnant ayant pour titre
“The next Documenta should be curated by an artist“ http://www.e-flux.com/projects/next_doc/index.html